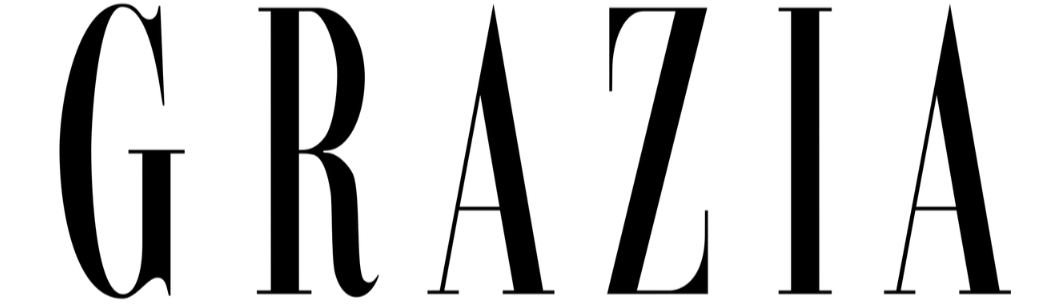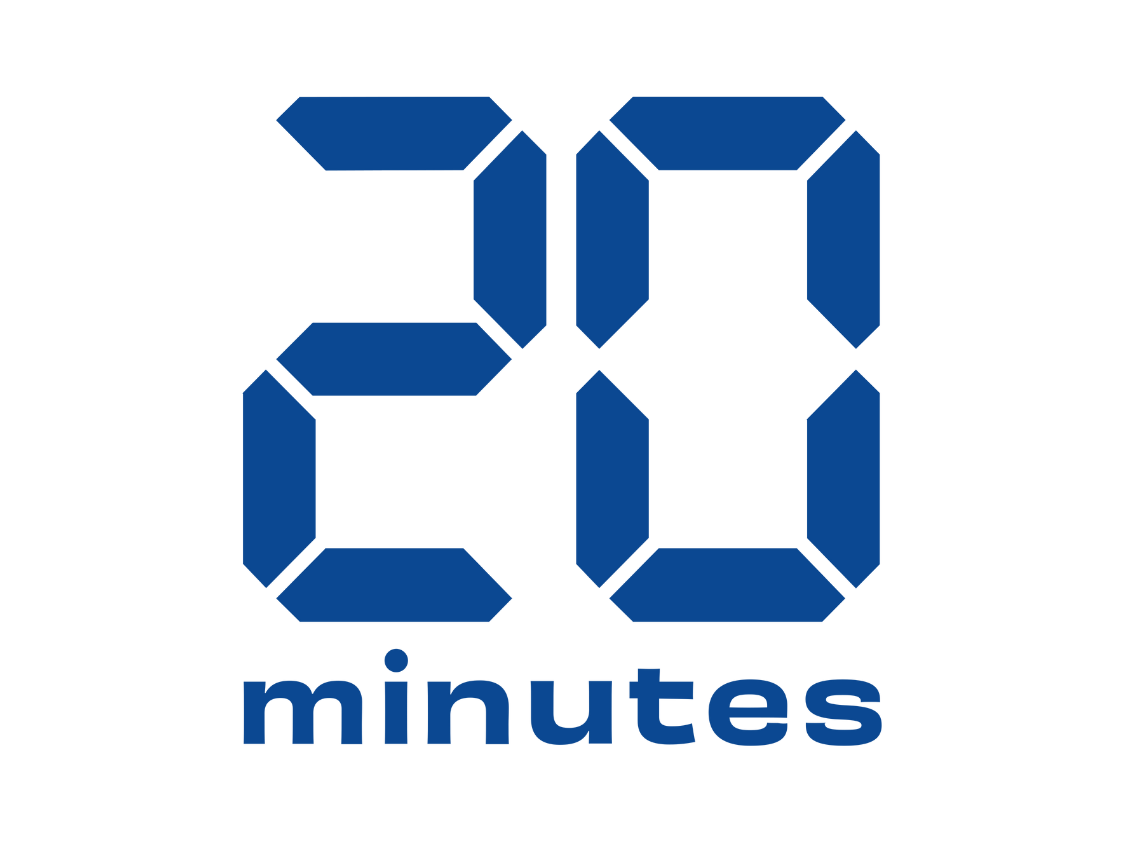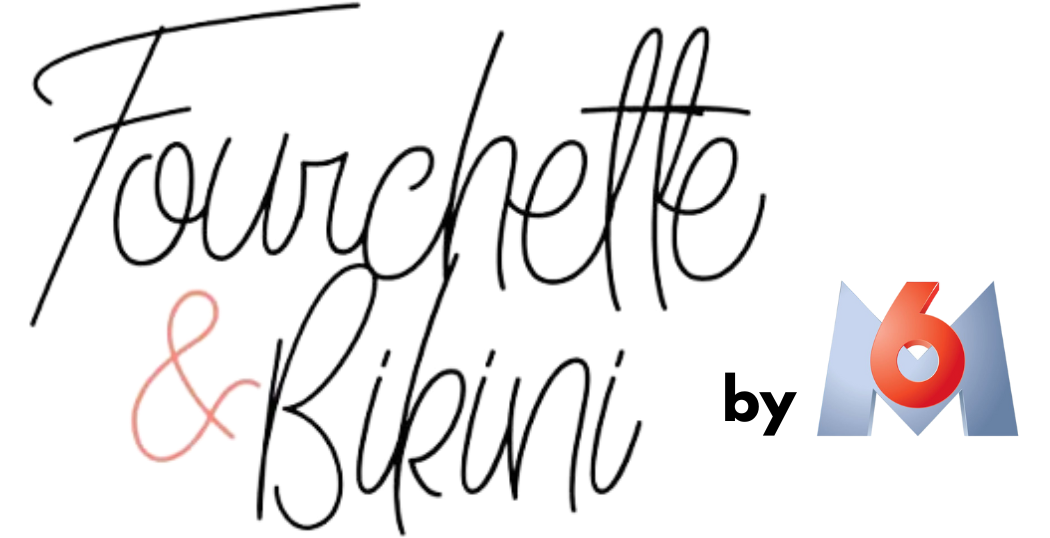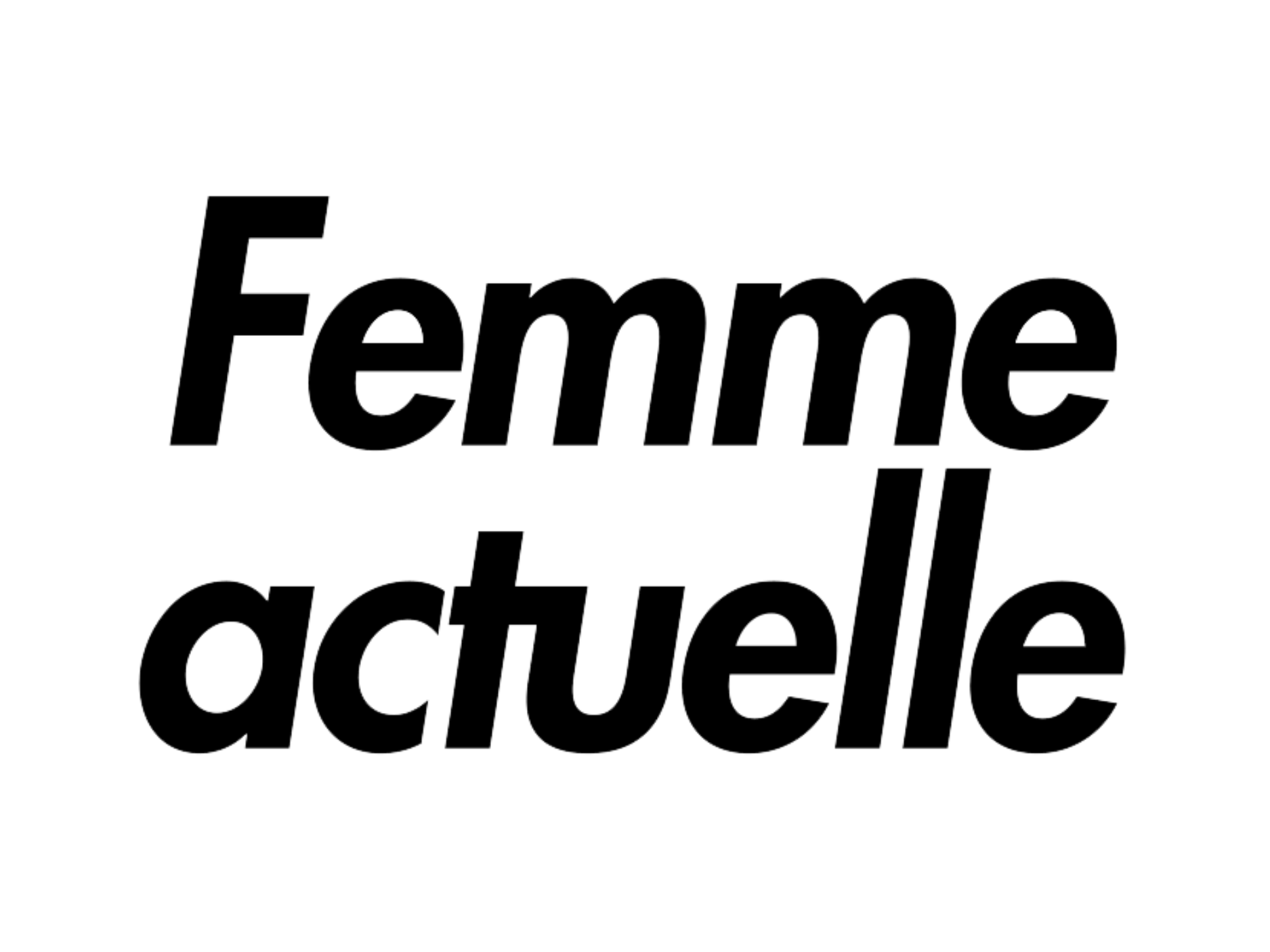- 1. Berbérine : rappel rapide et lien avec le métabolisme des lipides
- 2. Mécanismes d'action sur le cholestérol et les triglycérides
- 3. Ce que disent les études cliniques (LDL-C, HDL-C, TG, ApoB)
- 4. Place de la berbérine : hygiène de vie, complémentarité et limites
- 5. Posologie, durée, formes et tolérance
- 6. Précautions, interactions et profils concernés
- Conclusion
- FAQ
- Références scientifiques
Le cholestérol joue un rôle essentiel dans l’organisme, mais un excès de lipides circulants — notamment de LDL-cholestérol ou de triglycérides — augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Si les approches classiques reposent souvent sur des médicaments hypolipémiants, la recherche met aujourd’hui en lumière des solutions naturelles capables de soutenir l’équilibre lipidique de manière complémentaire. Parmi elles, la berbérine attire particulièrement l’attention.
Issue de plantes médicinales comme le Berberis aristata ou le Coptis chinensis, la berbérine est un alcaloïde naturel traditionnellement utilisé pour ses effets métaboliques. Des études récentes ont montré qu’elle agit directement sur les voies lipidiques et énergétiques, contribuant à réduire le cholestérol total, le LDL-C et les triglycérides, tout en favorisant une légère hausse du HDL-C — le “bon” cholestérol.
Cet article explore de manière détaillée comment la berbérine influence le métabolisme des lipides, à travers ses mécanismes moléculaires, les résultats cliniques documentés et son intégration possible dans une approche globale de santé métabolique.
1. Berbérine : rappel rapide et lien avec le métabolisme des lipides
La berbérine est un alcaloïde naturel extrait de plusieurs plantes médicinales, dont Berberis aristata, Coptis chinensis et Hydrastis canadensis. Utilisée depuis l’Antiquité dans les pharmacopées asiatiques pour ses effets digestifs et métaboliques, elle bénéficie aujourd’hui d’un regain d’intérêt en raison de son impact documenté sur le métabolisme des glucides et des lipides. Contrairement à d’autres actifs naturels ciblant un mécanisme unique, la berbérine exerce une action multicible, ce qui en fait un composé particulièrement pertinent dans la gestion des profils lipidiques déséquilibrés.
Sur le plan biochimique, elle se distingue par sa capacité à agir à la fois au niveau cellulaire, hépatique, intestinal et métabolique global. Cette vision systémique est cruciale pour comprendre pourquoi la berbérine influence des paramètres aussi variés que le LDL-cholestérol, les triglycérides, les acides biliaires ou encore l’ApoB, un marqueur reconnu du risque cardiovasculaire.
Un actif naturel au croisement des grandes voies métaboliques
La berbérine n’agit pas comme les brûleurs de graisse stimulants ou les molécules thermogéniques. Elle modifie la manière dont les cellules produisent et utilisent l’énergie, notamment en influençant :
- la synthèse des lipides,
- l’oxydation des acides gras,
- le transport et l’élimination du cholestérol,
- la stabilité des récepteurs LDL dans le foie,
- la production d’insuline et la sensibilité de l’organisme à celle-ci.
Cette approche en profondeur donne à la berbérine un profil très différent des compléments classiques : elle agit lentement mais solidement, et ses bénéfices apparaissent de manière progressive lorsque l’organisme se rééquilibre.
Un lien étroit avec le métabolisme glucidique et la sensibilité à l’insuline
On sait aujourd’hui que les troubles lipidiques sont souvent associés à une résistance à l’insuline. Lorsque les cellules n’utilisent plus correctement le glucose, l’organisme compense en augmentant la production de lipides hépatiques, entraînant une hausse du LDL, des triglycérides, et parfois une baisse du HDL.
Or, la berbérine est l’un des rares actifs naturels capables de :
- améliorer la sensibilité à l’insuline,
- réduire la gluconéogenèse hépatique,
- activer la voie énergétique AMPK,
- diminuer la production excessive de lipides dans le foie.
Cette action croisée explique pourquoi les études rapportent des effets simultanés sur la glycémie et sur les lipides sanguins.
Une influence directe sur le microbiote et les acides biliaires
Le microbiote intestinal joue un rôle majeur dans la régulation du cholestérol. Il intervient notamment dans :
- la transformation des acides biliaires,
- l’absorption intestinale des graisses,
- la production de métabolites liés au foie.
La berbérine agit comme un modulateur sélectif du microbiote, soutenant certaines souches bénéfiques et réduisant les bactéries associées aux dyslipidémies.
Ces modifications ont des effets en cascade :
- meilleure gestion des acides biliaires,
- plus grande excrétion du cholestérol,
- diminution de la lipogenèse hépatique,
- amélioration du rapport LDL/HDL.
Un actif qui influence les marqueurs athérogènes
Outre les lipides classiques, la berbérine démontre dans plusieurs essais cliniques une action sur des marqueurs plus précis :
- ApoB, un indicateur fiable du nombre de particules LDL athérogènes ;
- non-HDL-cholestérol, paramètre très utilisé par les cardiologues ;
- oxydation des LDL, un facteur clé dans la progression de l’athérosclérose.
Ce positionnement place la berbérine parmi les rares actifs naturels pouvant influencer des marqueurs cliniquement pertinents, en dehors du simple cholestérol total.
Certaines études suggèrent que la berbérine peut augmenter le nombre de récepteurs LDL présents à la surface des cellules hépatiques. Plus de récepteurs signifie une meilleure capacité du foie à « capturer » le LDL circulant, ce qui contribue naturellement à la réduction du cholestérol.
2. Mécanismes d’action sur le cholestérol et les triglycérides
Les effets de la berbérine sur le cholestérol et les triglycérides ne relèvent pas du hasard : ils reposent sur une combinaison de mécanismes biologiques complémentaires, validés par des études cellulaires, animales et cliniques. Contrairement à d’autres actifs naturels ciblant un seul levier, la berbérine agit sur plusieurs voies métaboliques en même temps, ce qui explique la cohérence et la reproductibilité des résultats observés dans les essais.
Activation de l’AMPK : le “chef d’orchestre” de l’équilibre lipidique
L’une des actions les plus importantes de la berbérine est l’activation de l’enzyme AMPK (AMP-activated protein kinase).
Cette enzyme agit comme un interrupteur métabolique responsable de :
- réduire la synthèse de nouveaux lipides (lipogenèse),
- augmenter l’oxydation des acides gras,
- améliorer la sensibilité à l’insuline,
- diminuer la production de glucose hépatique,
- stimuler la production énergétique cellulaire.
Lorsqu’elle active l’AMPK, la berbérine repositionne le métabolisme dans un mode plus “économe”, moins axé sur le stockage des graisses et davantage sur leur utilisation.
Réduction de la synthèse lipidique hépatique
La berbérine interfère directement avec les voies enzymatiques responsables de la production de lipides dans le foie.
Elle contribue notamment à :
- inhiber l’expression de SREBP-1c, un facteur clé de la lipogenèse,
- réduire l’activité de l’acétyl-CoA carboxylase (ACC),
- atténuer la production de HMG-CoA réductase, enzyme également ciblée par les statines,
- limiter la formation des VLDL, précurseurs des LDL circulants.
L’ensemble de ces actions diminue la quantité de lipides produits et relâchés dans le sang.
Amélioration de l’élimination du LDL grâce aux récepteurs LDL
L’un des mécanismes les plus documentés concerne l’effet de la berbérine sur les récepteurs LDL présents à la surface des cellules du foie.
La berbérine :
- augmente le nombre de récepteurs LDL,
- améliore leur stabilité,
- renforce leur activité,
ce qui permet au foie de capter davantage de LDL circulants.
Résultat :
→ diminution du LDL-C,
→ diminution de l’ApoB,
→ amélioration du profil athérogène global.
Cette action est particulièrement intéressante car elle fonctionne sans influencer la voie PCSK9 de la même façon que les statines, offrant un mécanisme complémentaire.
Action sur le microbiote et les acides biliaires
Le microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans la gestion du cholestérol, notamment grâce aux acides biliaires.
La berbérine a montré qu’elle pouvait :
- moduler favorablement certaines familles bactériennes,
- améliorer la déconjugaison des acides biliaires,
- augmenter leur élimination,
- réduire la réabsorption du cholestérol dans l’intestin.
Cette action intégrée microbe–foie participe fortement à la baisse du LDL et des triglycérides.
Réduction des triglycérides circulants
Les effets de la berbérine sur les triglycérides reposent sur :
- une diminution de la production hépatique de VLDL,
- une meilleure utilisation des acides gras par activation de l’AMPK,
- une amélioration de la sensibilité à l’insuline,
- une réduction du stockage des graisses dans le tissu adipeux viscéral.
Cliniquement, ces actions se traduisent souvent par des baisses de 20 à 30 % des triglycérides chez les sujets présentant des anomalies initiales.
Protection contre l’oxydation des LDL
L’oxydation des LDL est un facteur clé du développement de l’athérosclérose.
La berbérine exerce une action :
- antioxydante,
- anti-inflammatoire,
- et modulatrice du stress oxydatif cellulaire.
En réduisant l’oxydation des LDL, elle limite la formation de plaques d’athérome potentiellement instables.
3. Ce que disent les études cliniques (LDL-C, HDL-C, TG, ApoB)
Les effets de la berbérine sur les lipides sanguins ne reposent pas uniquement sur des modèles théoriques : ils sont soutenus par un corpus solide d’études cliniques menées sur des populations variées (dyslipidémies, diabète de type 2, syndrome métabolique, surpoids).
Les résultats convergent : la berbérine améliore significativement le profil lipidique, souvent avec une amplitude comparable à certains traitements de référence lorsqu’elle est bien dosée et utilisée régulièrement.
Une réduction nette du LDL-cholestérol
Plusieurs essais randomisés contrôlés ont montré que la berbérine peut réduire le LDL-C de manière significative.
Les données les plus fréquentes rapportent :
- −20 à −25 % de baisse du LDL-C après 8 à 12 semaines,
- une amélioration observée même chez des patients déjà sous mesures hygiéno-diététiques,
- un effet renforcé chez les personnes présentant un LDL initialement élevé.
Un point essentiel ressort des études :
→ La baisse du LDL ne dépend pas uniquement de la réduction de la synthèse lipidique, mais surtout de l’augmentation du nombre de récepteurs LDL hépatiques, un mécanisme rare pour un actif naturel.
Effets sur le HDL : une amélioration modérée mais intéressante
Le HDL-C bénéficie également d’une légère amélioration, généralement :
- entre +2 et +5 %,
- observée surtout chez les personnes présentant un HDL bas au départ,
- liée à l’effet modulateur de la berbérine sur les acides biliaires et la sensibilité à l’insuline.
Même si la hausse est modeste, elle contribue à améliorer le ratio LDL/HDL, un indicateur clé pour l’évaluation du risque cardiovasculaire.
Une diminution des triglycérides souvent spectaculaire
Les triglycérides (TG) sont les marqueurs les plus sensibles à la berbérine.
Les études montrent régulièrement :
- −25 à −35 % de baisse,
- des améliorations rapides dès 4 à 6 semaines,
- une efficacité renforcée chez les patients présentant une insulinorésistance ou un foie gras non alcoolique (NAFLD).
Cette diminution importante s’explique par l’impact de la berbérine sur :
- la production de VLDL,
- la sensibilité à l’insuline,
- l’oxydation des acides gras via la voie AMPK.
Effets sur ApoB, non-HDL et autres marqueurs athérogènes
Les marqueurs cardiométaboliques les plus pertinents ne sont pas seulement le cholestérol total ou le LDL, mais :
- ApoB (nombre de particules LDL athérogènes),
- non-HDL-cholestérol,
- le ratio TG/HDL,
- l’index d’athérogénicité.
Sur ces paramètres, la berbérine montre :
- une réduction notable de l’ApoB, signe d’une diminution effective des particules athérogènes,
- une baisse du non-HDL-C, indicateur très utilisé en prévention cardiovasculaire,
- une amélioration du ratio TG/HDL, associé au risque cardiométabolique.
Ces résultats renforcent l’idée que la berbérine agit au-delà du simple “cholestérol”, et exerce un effet global sur le risque cardiovasculaire métabolique.
Études comparatives avec des traitements de référence
Certaines publications ont comparé la berbérine à des médicaments hypolipémiants, notamment les statines modérées.
Les conclusions montrent que :
- la baisse du LDL-C peut être comparable à celle d’une statine faible dose,
- les effets sur ApoB et non-HDL sont souvent supérieurs à ceux de certaines molécules végétales classiques,
- la combinaison berbérine + hygiène de vie produit une amélioration clinico-biologique très cohérente.
Il ne s’agit pas de substituer un traitement médical, mais ces données soulignent le potentiel thérapeutique de cet actif, surtout en complément ou pour des profils qui ne tolèrent pas certains traitements.
Pour optimiser les effets de la berbérine sur le cholestérol, associez-la à une alimentation riche en fibres solubles (flocons d’avoine, psyllium, légumineuses) et en graisses insaturées. Ces synergies renforcent naturellement la baisse du LDL et des triglycérides.
4. Place de la berbérine : hygiène de vie, complémentarité et limites
La berbérine présente un potentiel notable pour améliorer le profil lipidique, mais elle ne constitue pas une solution isolée. Son efficacité réelle dépend toujours du contexte global : hygiène de vie, alimentation, activité physique, métabolisme de base et état de santé général. Comprendre la place exacte de la berbérine dans une stratégie de rééquilibrage lipidique permet de l’utiliser de façon optimale et réaliste.
La berbérine comme pilier complémentaire d’une hygiène de vie équilibrée
La berbérine fonctionne particulièrement bien lorsqu’elle s’inscrit dans une démarche structurée visant à améliorer le métabolisme. Elle agit en synergie avec :
- une alimentation riche en fibres, notamment en fibres solubles ;
- une consommation régulière de graisses insaturées (oméga-3, monoinsaturées) ;
- une réduction des sucres rapides et des aliments ultra-transformés ;
- une activité physique régulière, en particulier des exercices combinant cardio + renforcement musculaire ;
- un sommeil suffisant et une bonne gestion du stress.
Cette synergie repose sur un point central : la berbérine renforce les mécanismes que l’hygiène de vie active naturellement. Ce n’est pas un substitut, mais un amplificateur métabolique cohérent.
Une complémentarité intéressante dans les stratégies de gestion des lipides
Dans plusieurs études, la berbérine a démontré un effet complémentaire aux approches classiques de gestion du cholestérol. Elle peut :
- renforcer l’action d’une alimentation pauvre en graisses saturées ;
- optimiser les résultats des personnes suivant un programme de perte de poids ;
- compléter certaines prises en charge (uniquement sous supervision médicale) ;
- être envisagée en soutien pour les personnes présentant une intolérance légère à certains traitements hypolipémiants.
La berbérine est particulièrement pertinente pour les profils suivants :
- personnes présentant une résistance à l’insuline,
- sujets avec LDL modérément élevé,
- individus affichant une élévation des triglycérides,
- personnes avec un stress oxydatif élevé ou une inflammation de bas grade,
- adultes ayant des profils métaboliques fluctuants ou instables.
Les limites : quand la berbérine ne suffit pas
Malgré son potentiel, la berbérine possède des limites importantes qu’il convient de rappeler :
- Elle n’agit pas aussi rapidement que certains traitements pharmacologiques.
- Les résultats optimaux nécessitent une prise continue sur plusieurs semaines.
- Elle ne peut ni remplacer un médicament prescrit, ni traiter une dyslipidémie sévère.
- Son efficacité dépend largement de la qualité de l’extrait et de la dose réellement absorbée.
Dans les cas de dyslipidémie forte ou dans certaines conditions médicales, seule une prise en charge médicale adaptée permet d’obtenir les effets recherchés.
Une approche réaliste et fondée sur les données
Avec sa capacité à améliorer le LDL-C, les triglycérides et les marqueurs athérogènes, la berbérine occupe une place unique parmi les actifs naturels validés scientifiquement. Cependant, son rôle doit être compris comme celui d’un levier complémentaire, utile pour renforcer les fondations d’une stratégie métabolique globale.
5. Posologie, durée, formes et tolérance
La berbérine fait partie des actifs naturels dont l’efficacité dépend fortement de la posologie, de la forme utilisée, de la qualité de l’extrait et de la régularité de la prise. Les études cliniques fournissent des repères solides permettant d’orienter son utilisation dans l’amélioration du profil lipidique.
Dosage recommandé d’après les études cliniques
Les recherches disponibles convergent vers des posologies relativement similaires :
- 500 mg, 2 à 3 fois par jour, soit 1000 à 1500 mg/j,
- sous forme de berbérine pure ou standardisée,
- souvent administrée avant ou pendant les repas pour optimiser l’absorption.
Ce dosage est celui qui a montré les effets les plus constants sur :
- la baisse du LDL-C,
- la baisse des triglycérides,
- l’amélioration de l’ApoB,
- la diminution du non-HDL.
La prise peut être ajustée selon les besoins individuels, mais les doses inférieures à 500 mg/j montrent rarement des effets cliniquement significatifs.
Durée d’une cure efficace
Les effets sur le cholestérol et les triglycérides ne sont pas immédiats :
- 4 à 6 semaines : premières améliorations, surtout sur les triglycérides,
- 8 à 12 semaines : résultats complets et stabilisés,
- 12+ semaines : bénéfices additionnels sur ApoB et le non-HDL.
Pour un maintien sur le long terme, les études suggèrent :
- des cycles de 8 à 12 semaines,
- suivis d’une pause courte de 1 à 2 semaines,
- ou une prise continue sous suivi de bilan sanguin.
Formes disponibles : laquelle privilégier ?
La berbérine existe sous plusieurs formes, mais toutes ne se valent pas :
- Berbérine HCl : forme la plus utilisée en études, bonne stabilité.
- Berbérine standardisée : garantit un dosage constant et des taux mesurables.
- Complexes berbérine + plantes : utiles, mais moins bien documentés scientifiquement.
Les formes liposomales ou optimisées existent, mais restent encore peu étudiées dans le contexte des lipides sanguins.
Critères de qualité pour un extrait efficace
Pour bénéficier de résultats cohérents, il est essentiel de choisir un produit :
- standardisé,
- certifié sans contaminants (métaux lourds, solvants),
- issu d’une analyse indépendante,
- avec traçabilité claire.
La variabilité de qualité observée sur le marché explique souvent les différences d'efficacité rapportées par les utilisateurs.
Tolérance et effets secondaires possibles
La berbérine est globalement bien tolérée, mais certains effets peuvent apparaître, surtout les premières semaines :
- inconfort digestif (ballonnements, selles plus molles),
- légère constipation ou diarrhée chez certains profils,
- sensation de baisse de la glycémie (rare).
Ces effets sont généralement transitoires et diminuent :
- en démarrant par 1 dose/j la première semaine,
- en prenant la berbérine au repas,
- en maintenant une bonne hydratation et un apport suffisant en fibres.
À qui la berbérine est-elle particulièrement adaptée ?
Elle peut être pertinente pour les personnes :
- présentant un LDL-C modérément élevé,
- ayant des triglycérides supérieurs aux normes,
- souffrant d’une résistance à l’insuline,
- ayant un profil métabolique instable,
- recherchant une approche naturelle complémentaire à l’hygiène de vie.
Évitez de prendre la berbérine en même temps que des médicaments hypoglycémiants ou anticoagulants sans avis médical. Certaines interactions peuvent potentialiser les effets des traitements et nécessitent une surveillance adaptée.
6. Précautions, interactions et profils concernés
Même si la berbérine est un actif naturel reconnu pour son efficacité et sa bonne tolérance générale, son utilisation nécessite certaines précautions. Comme pour tout composé influençant le métabolisme, il est essentiel de comprendre dans quels cas elle convient parfaitement, dans quels cas elle doit être utilisée avec prudence, et dans quels cas elle est déconseillée.
Profils pour lesquels la berbérine est particulièrement pertinente
La berbérine peut constituer un soutien intéressant pour :
- les personnes présentant un LDL modérément élevé,
- celles ayant des triglycérides élevés ou un profil lipidique déséquilibré,
- les individus souffrant de résistance à l’insuline ou de glycémie instable,
- les personnes ayant une stéatose hépatique métabolique (NAFLD),
- les sujets en situation de surpoids associé à des désordres métaboliques,
- ceux souhaitant améliorer leur métabolisme global de manière naturelle et progressive.
Ces profils correspondent à la majorité des cas où les études cliniques ont observé une amélioration significative des marqueurs lipidaires.
Situations nécessitant une vigilance renforcée
Certaines conditions appellent une évaluation plus attentive avant d’intégrer la berbérine dans une stratégie de santé métabolique. La prudence est recommandée pour les personnes :
- sous traitement pour le diabète de type 2 (metformine, insuline, glinides, sulfamides) ;
- suivant un traitement anticoagulant (warfarine, certains AOD) ;
- ayant une polymédication (plus de 3 traitements réguliers) ;
- présentant une hypotension ou une tendance aux malaises vagaux ;
- ayant connu des effets secondaires digestifs avec des compléments similaires.
Dans ces situations, un avis médical ou pharmaceutique est préférable afin d’éviter des interactions ou des effets cumulés.
Interactions médicamenteuses possibles
Bien que les interactions graves soient rares, la berbérine peut potentialiser ou moduler certains traitements :
- hypoglycémiants : risque d’accentuer la baisse de la glycémie,
- anticoagulants : modulation possible de l’activité des enzymes hépatiques impliquées dans le métabolisme des médicaments,
- immunosuppresseurs : influence potentielle sur certaines voies métaboliques,
- antihypertenseurs : légère synergie hypotensive à surveiller chez les profils sensibles.
Ceci ne signifie pas que la berbérine est incompatible, mais que son introduction doit être supervisée lorsqu’un traitement médical est déjà en place.
Contre-indications et cas où la berbérine est déconseillée
Il existe également des contextes dans lesquels la berbérine ne doit pas être utilisée :
- grossesse et allaitement, faute de données suffisantes ;
- enfants et adolescents, sauf avis médical éclairé ;
- insuffisance hépatique sévère ;
- insuffisance rénale avancée ;
- antécédents de réactions allergiques sévères à des composés végétaux proches.
Ces précautions correspondent aux recommandations habituelles pour de nombreux actifs métaboliques.
Signes d’alerte à surveiller
Même si les effets indésirables sont peu fréquents, certains signes nécessitent une interruption temporaire et un avis professionnel :
- troubles digestifs persistants,
- fatigue inhabituelle ou sensations d’hypoglycémie,
- palpitations,
- coloration anormale des selles ou de l’urine,
- symptômes inexpliqués survenant après l’introduction de la berbérine.
Dans la grande majorité des cas, ces symptômes sont bénins, transitoires ou liés à un dosage trop élevé.
Conclusion
La berbérine occupe aujourd’hui une place singulière parmi les actifs naturels soutenant la santé métabolique. Loin d’être un simple remède traditionnel, elle présente un profil d’action scientifiquement documenté, capable d’influencer des marqueurs aussi essentiels que le LDL-cholestérol, les triglycérides, l’ApoB ou encore le non-HDL-C.
Cette molécule naturelle agit en profondeur sur les grandes voies métaboliques : activation de l’AMPK, réduction de la lipogenèse hépatique, modulation du microbiote, amélioration de la sensibilité à l’insuline et optimisation du recyclage du cholestérol par les récepteurs LDL. Ses effets complémentaires sur les marqueurs athérogènes renforcent encore son intérêt dans une stratégie globale visant à rééquilibrer les lipides sanguins et à réduire le risque cardiométabolique.
Cependant, la berbérine n’est pas un substitut aux traitements médicaux. Elle déploie tout son potentiel lorsqu’elle est intégrée dans un cadre cohérent : alimentation riche en fibres, activité physique régulière, gestion du stress et qualité du sommeil. Bien utilisée, avec un dosage adapté et un extrait standardisé, elle peut devenir un allié naturel puissant pour soutenir les lipides sanguins, le foie, le métabolisme énergétique et la santé cardiovasculaire.
Combien de temps faut-il pour observer les effets de la berbérine sur le cholestérol ?
Les premières améliorations apparaissent en général après 4 à 6 semaines, avec des résultats plus complets après 8 à 12 semaines de prise régulière.
La berbérine peut-elle remplacer un traitement contre le cholestérol ?
Non, la berbérine ne remplace pas un traitement médical. Elle peut soutenir l’équilibre lipidique mais ne doit pas se substituer à une prise en charge professionnelle.
Quel dosage est recommandé pour agir sur les lipides sanguins ?
Les études utilisent généralement 1000 à 1500 mg par jour, répartis en deux ou trois prises avant ou pendant les repas.
Existe-t-il des interactions avec des médicaments ?
Oui, notamment avec certains hypoglycémiants ou anticoagulants. Un avis médical est recommandé en cas de traitement en cours.
La berbérine améliore-t-elle aussi les triglycérides ?
Oui, les études montrent une diminution de 25 à 35 % des triglycérides grâce à l’action de la berbérine sur la lipogenèse et l’oxydation des acides gras.
Peut-on associer la berbérine à d’autres compléments naturels ?
Oui, l’association avec les fibres solubles, les oméga-3 ou certains polyphénols peut renforcer son action sur le métabolisme lipidique.
1. Zhang, Y. et al. (2008). Berberine lowers blood glucose and lipids in type 2 diabetes patients. Metabolism, 57(5), 712–717.
2. Affuso, F. et al. (2010). Effects of a nutraceutical combination containing berberine on lipid levels and endothelial function. Clinical Lipidology, 5(5), 525–530.
3. Lan, J. et al. (2015). The effects of berberine on dyslipidemia: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 10(6), e0131930.
4. Zhao, L. et al. (2021). Berberine improves lipid metabolism through modulating gut microbiota and hepatic AMPK pathways. Frontiers in Pharmacology, 12, 653–714.
5. Ju, J. et al. (2018). Berberine activates AMPK to suppress hepatic cholesterol biosynthesis and lower plasma cholesterol. International Journal of Molecular Sciences, 19(11), 3381.
6. Derosa, G. et al. (2012). Berberine on metabolic syndrome: Results from a clinical study. Phytotherapy Research, 26(3), 444–450.
7. Zhang, X. et al. (2019). Effects of berberine on triglyceride metabolism and VLDL assembly. Journal of Lipid Research, 60(11), 1993–2003.
8. Cicero, A.F.G. et al. (2020). Nutraceutical effects on lipids and cardiovascular risk: Focus on berberine. Nutrition & Metabolism, 17(1), 5–15.
9. Lee, Y.S. et al. (2006). Berberine activates AMPK as a central regulator of lipid metabolism. Nature Medicine, 12(10), 1344–1350.
10. Kong, W. et al. (2004). Berberine is a cholesterol-lowering drug working through a unique mechanism distinct from statins. Nature Medicine, 10(12), 1344–1351.