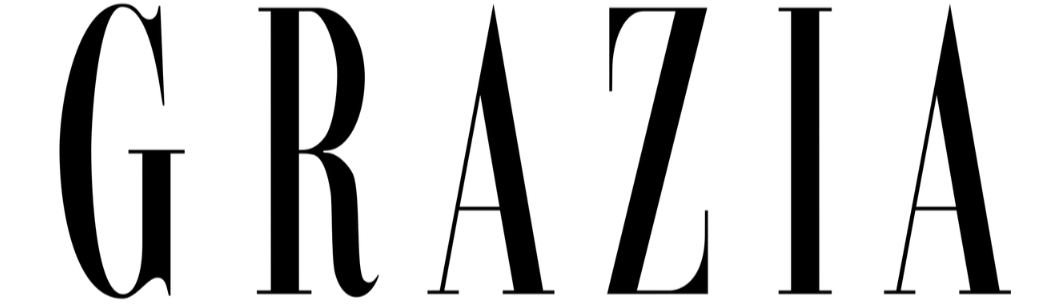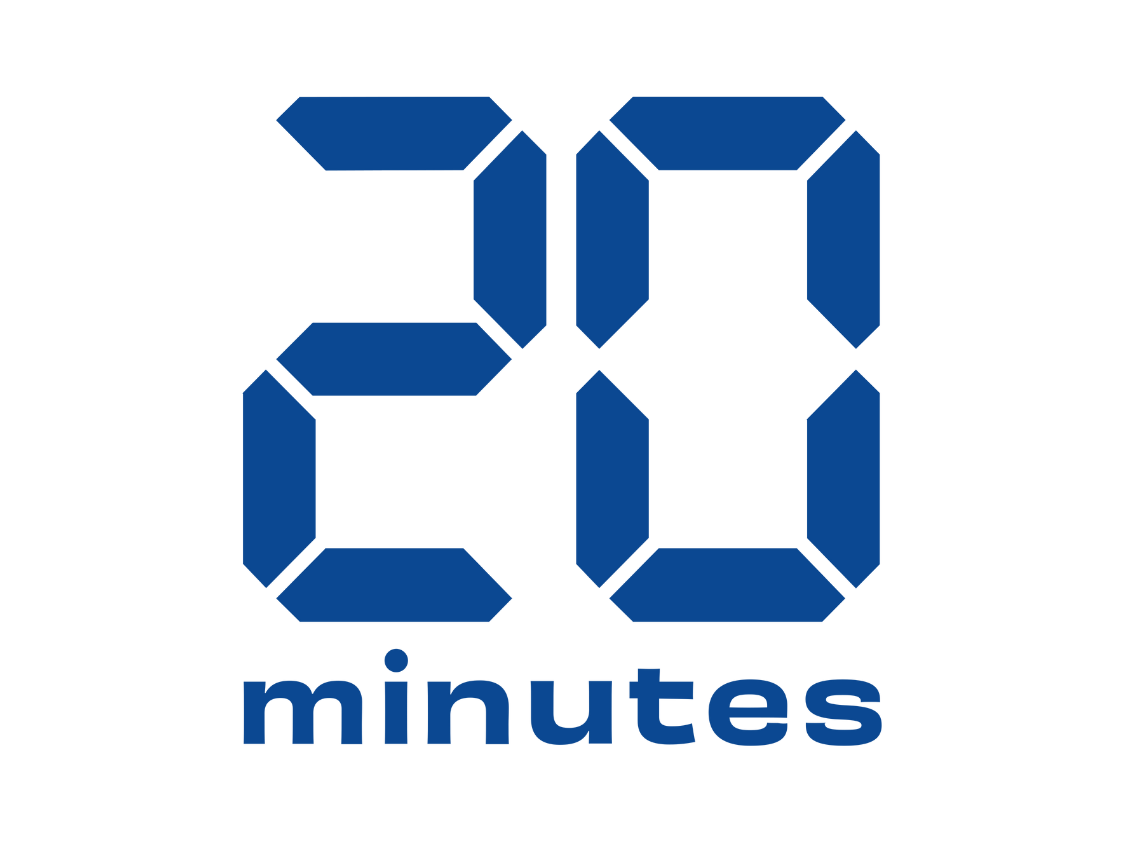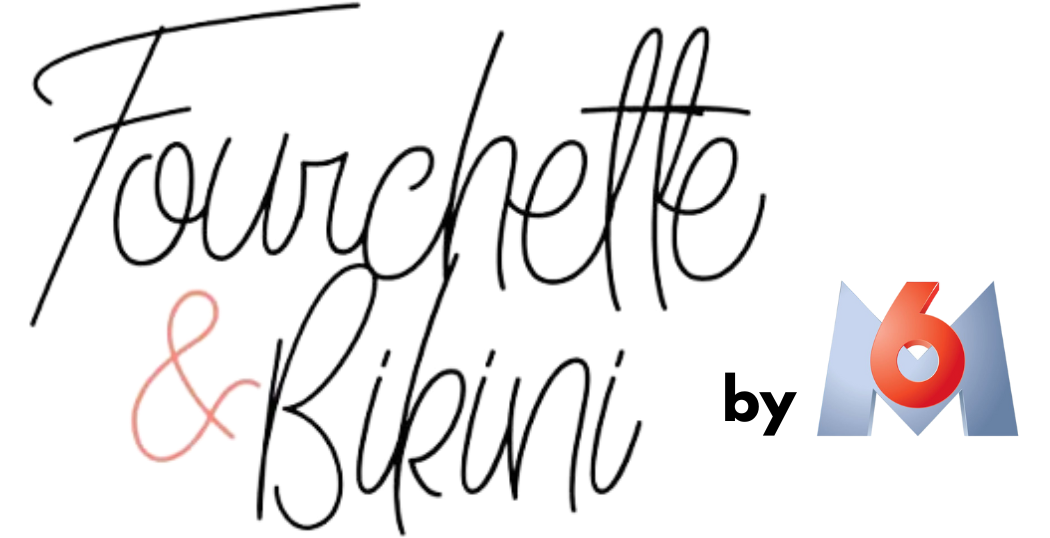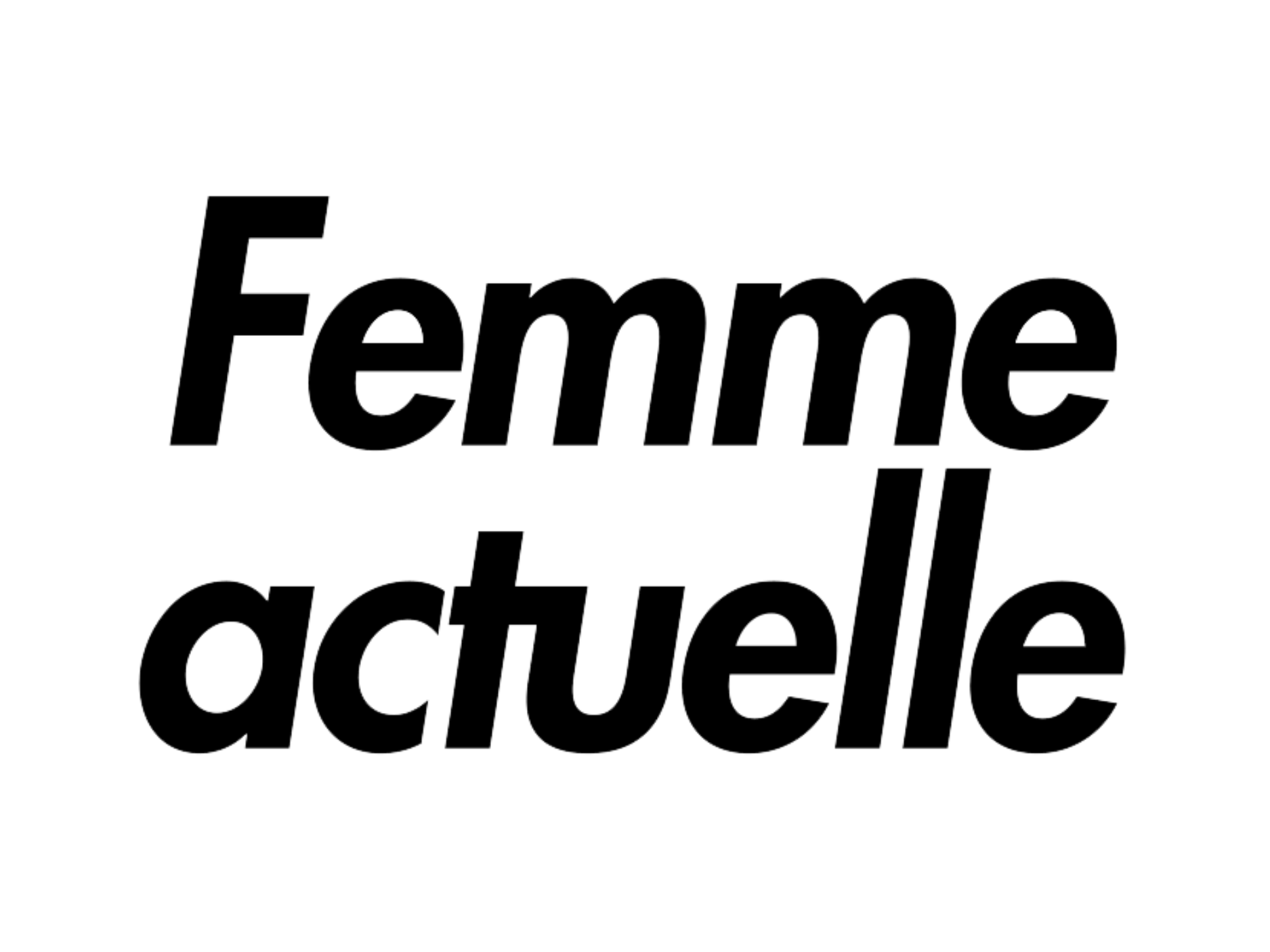- 1. Spiruline bleue : définition, origine et composition
- 2. Hydratation cellulaire : mécanisme et mesures
- 3. Données précliniques : in vitro et modèles animaux
- 4. Données humaines : ce que montrer (et ne montrer pas) les essais
- 5. Mécanismes plausibles de soutien à l'hydratation
- 6. Conseils pratiques (non médicaux) et usage responsable
- 7. Conclusion
- 8. FAQ
- 9. Références scientifiques
L’hydratation cellulaire est un processus essentiel qui assure la vitalité de la peau, l’élasticité des tissus et le bon fonctionnement métabolique. Lorsqu’elle est optimale, les cellules conservent leur équilibre hydrique, protègent la barrière cutanée et résistent mieux aux agressions extérieures. Depuis quelques années, la spiruline bleue, riche en phycocyanine, attire l’attention pour son potentiel à soutenir indirectement ce mécanisme.
La phycocyanine, pigment bleu extrait de la spiruline, possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces caractéristiques pourraient contribuer à préserver l’intégrité des membranes cellulaires et des lipides cutanés, éléments clés de la rétention d’eau. Certaines hypothèses avancent même une influence possible sur les aquaporines, protéines régulant les flux d’eau à travers les membranes.
Cependant, entre données précliniques prometteuses et preuves cliniques encore limitées, la question demeure ouverte. Cet article propose une analyse critique des études disponibles afin de distinguer ce qui est établi, ce qui reste plausible, et ce qui doit encore être démontré concernant le lien entre spiruline bleue et hydratation cellulaire.
1. Spiruline bleue : définition, origine et composition
Qu’appelle-t-on « spiruline bleue » ?
La spiruline est une cyanobactérie microscopique du genre Arthrospira, connue depuis longtemps pour sa richesse en protéines, vitamines, minéraux et pigments. Elle est généralement cultivée dans des bassins d’eau douce, sous des conditions contrôlées de température, de lumière et de pH, afin de maximiser sa croissance et sa teneur en nutriments.
Le terme « spiruline bleue » ne désigne pas la spiruline entière, mais un extrait spécifique : la phycocyanine. Ce pigment bleu-vert est une protéine associée à des chromophores, qui lui confèrent sa couleur intense. Utilisée comme colorant naturel dans l’agroalimentaire, elle est également étudiée pour ses propriétés biologiques, notamment antioxydantes et anti-inflammatoires.
Phycocyanine vs spiruline entière : quelles différences ?
La spiruline entière est une source alimentaire complète, apportant des protéines (environ 60 % de sa masse sèche), des acides gras essentiels, des minéraux (fer, magnésium, zinc) et des vitamines (B1, B2, B12 sous forme discutée). La phycocyanine, en revanche, est un fractionnement ciblé, qui concentre surtout le pigment-protéine responsable de la couleur bleue.
Cette distinction est importante car les effets biologiques attribués à la spiruline bleue concernent souvent la phycocyanine isolée, et non l’ensemble de la spiruline. Cela signifie que les études doivent préciser la nature exacte de l’extrait utilisé (spiruline entière vs phycocyanine purifiée) pour que l’on puisse en tirer des conclusions fiables.
La phycocyanine, pigment phare de la spiruline bleue, est capable d’absorber la lumière dans le spectre rouge et orange pour la transformer en énergie utilisable par l’organisme. Cette propriété photosensible, qui sert à la cyanobactérie pour la photosynthèse, est aussi étudiée pour ses applications potentielles en biotechnologie et en cosmétique.
Standardisation, pureté et stabilité des extraits
Un des principaux défis avec la spiruline bleue réside dans la stabilité de la phycocyanine. Cette molécule est sensible à la chaleur, à la lumière et aux variations de pH, ce qui peut entraîner une dégradation rapide et réduire son efficacité.
De plus, tous les extraits ne se valent pas. Certains contiennent seulement 15 à 20 % de phycocyanine, tandis que d’autres, hautement purifiés, peuvent dépasser 60 à 70 %. Le degré de pureté influence non seulement l’intensité colorante, mais aussi la bioactivité potentielle.
Enfin, les méthodes d’encapsulation (liposomale, microencapsulation, poudres protégées par matrices naturelles) permettent d’améliorer la biodisponibilité et la stabilité, garantissant que le pigment conserve son intégrité jusqu’à son absorption par l’organisme.
2. Hydratation cellulaire : mécanismes et mesures
Le rôle central des membranes cellulaires
L’hydratation cellulaire ne se résume pas simplement à la quantité d’eau présente dans l’organisme. Elle dépend avant tout de la capacité des cellules à retenir et réguler l’eau au sein de leurs membranes. Ces membranes sont constituées de lipides, de protéines et de cholestérol, formant une barrière semi-perméable qui contrôle l’entrée et la sortie des nutriments, des ions et de l’eau.
Lorsqu’elles sont bien structurées, les membranes permettent un équilibre hydrique stable. En revanche, une membrane fragilisée par le stress oxydatif, l’inflammation ou une carence en lipides essentiels peut perdre sa capacité à retenir l’eau. Résultat : une déshydratation intracellulaire qui affecte la vitalité des tissus, en particulier ceux de la peau.
Les aquaporines : portes de l’eau à travers la cellule
Un autre acteur clé de l’hydratation cellulaire est constitué par les aquaporines. Ces protéines transmembranaires fonctionnent comme de véritables « canaux » qui facilitent le passage de l’eau et de certaines petites molécules à travers la membrane cellulaire.
Parmi elles, l’aquaporine 3 (AQP3) joue un rôle majeur dans la peau. Localisée dans l’épiderme, elle contribue à l’élasticité, à la souplesse et à l’aspect lisse de la peau en régulant les flux hydriques. Or, il est démontré que l’activité des aquaporines peut être perturbée par plusieurs facteurs :
- Le vieillissement (diminution naturelle de l’expression d’AQP3).
- L’exposition aux rayons UV, qui altère la fonction des protéines membranaires.
- Le stress oxydatif, qui endommage les lipides et les protéines.
- Certains déséquilibres nutritionnels (carence en acides gras, en zinc ou en vitamines antioxydantes).
L’intérêt de molécules comme la phycocyanine réside dans leur capacité théorique à protéger l’intégrité membranaire et à réduire le stress oxydatif, conditions favorables au maintien du fonctionnement optimal des aquaporines.
Comment mesure-t-on l’hydratation cellulaire ?
Dans la recherche scientifique, l’hydratation ne se mesure pas à l’œil nu. Plusieurs méthodes, directes ou indirectes, sont utilisées :
- TEWL (Transepidermal Water Loss) : mesure la quantité d’eau qui s’évapore à travers la peau. Un TEWL faible est signe d’une barrière cutanée efficace.
- Capacitance ou conductance cutanée : techniques basées sur les propriétés électriques de la peau, qui permettent d’évaluer sa teneur en eau.
- Bio-impédance : utilisée en nutrition et en sport, cette méthode estime l’hydratation globale de l’organisme à partir de la résistance des tissus au passage d’un courant électrique.
- Imagerie avancée : certaines études utilisent la microscopie confocale ou la spectroscopie pour observer la répartition de l’eau dans les couches cutanées.
- Marqueurs biologiques : expression des gènes liés aux aquaporines, profil lipidique membranaire ou niveaux de stress oxydatif.
Ces outils permettent aux chercheurs de vérifier si un ingrédient ou un complément alimentaire a un effet réel sur la rétention d’eau au niveau cellulaire.
Facteurs qui influencent l’hydratation
Il serait réducteur d’attribuer l’hydratation cellulaire à un seul ingrédient. De nombreux facteurs agissent en synergie :
- Hydratation orale : la consommation quotidienne d’eau reste le premier facteur déterminant.
- Qualité du film hydrolipidique cutané : acides gras essentiels et céramides forment une barrière protectrice qui limite l’évaporation.
- Apport en micronutriments : le zinc, la vitamine C, la vitamine E et les polyphénols contribuent à la protection des membranes et des protéines impliquées.
- Environnement extérieur : exposition aux UV, pollution, variations de température et climat sec accélèrent la perte en eau.
- Âge et état hormonal : la baisse de certaines hormones (comme les œstrogènes) réduit la capacité de la peau à retenir l’eau.
- Mode de vie : tabac, alcool, alimentation déséquilibrée et stress chronique favorisent la déshydratation cellulaire.
Dans ce contexte, les ingrédients bioactifs comme la spiruline bleue sont étudiés non pas comme des solutions miracles, mais comme des adjuvants pouvant contribuer à renforcer la résistance cellulaire.
Pour optimiser l’hydratation cellulaire, il ne suffit pas d’apporter de l’eau. Associer une bonne hydratation orale à des nutriments protecteurs (vitamine C, acides gras essentiels, polyphénols) et à des habitudes simples comme limiter les expositions prolongées au soleil permet de renforcer l’efficacité naturelle des membranes et des aquaporines.
3. Données précliniques : in vitro et modèles animaux
Études in vitro : premiers indices prometteurs
Les recherches sur la spiruline bleue commencent souvent en laboratoire, sur des cultures cellulaires. L’objectif est de comprendre comment la phycocyanine influence la viabilité cellulaire, la résistance au stress oxydatif et l’équilibre hydrique.
Plusieurs travaux ont montré que la phycocyanine peut :
- Réduire la production de radicaux libres en condition de stress.
- Préserver l’intégrité membranaire des cellules exposées à des agents oxydants.
- Stimuler certaines voies de défense intracellulaire, comme le facteur Nrf2, connu pour activer les gènes antioxydants et cytoprotecteurs.
Ces effets, bien que prometteurs, ne constituent pas une preuve directe d’une amélioration de l’hydratation cellulaire. Ils suggèrent plutôt un terrain favorable, dans lequel les membranes et les protéines impliquées dans les flux d’eau pourraient fonctionner de manière optimale.
Modèles animaux : protection des tissus et homéostasie
Les modèles animaux permettent d’aller plus loin en observant l’effet d’un extrait sur un organisme entier. Quelques études ont testé la spiruline ou la phycocyanine sur des modèles de stress oxydatif, de déshydratation ou d’inflammation.
Résultats fréquents :
- Une réduction de la peroxydation lipidique, c’est-à-dire des dommages causés aux graisses membranaires par les radicaux libres.
- Une amélioration de la tolérance cutanée aux UV, avec une moindre altération des structures de la peau.
- Une diminution de l’inflammation systémique, souvent corrélée à une meilleure régénération cellulaire.
Dans certains cas, on observe aussi une stabilisation de la teneur en eau tissulaire chez les animaux exposés à des conditions de stress environnemental. Toutefois, ces résultats restent variables et dépendent beaucoup du type d’extrait utilisé, de sa pureté et de son dosage.
Limites de transposition vers l’humain
Malgré ces observations encourageantes, il faut rappeler plusieurs limites :
- Les conditions expérimentales (dose, durée, mode d’administration) ne sont pas comparables à celles de la vie réelle.
- Les animaux étudiés ne reproduisent pas toujours la complexité de la peau et du métabolisme humain.
- Les extraits utilisés dans ces études précliniques sont parfois très concentrés ou hautement purifiés, ce qui diffère des compléments disponibles dans le commerce.
Ainsi, si les données précliniques soutiennent l’idée que la spiruline bleue peut protéger les membranes cellulaires et limiter la perte en eau indirectement, elles ne permettent pas encore de conclure à un effet concret sur l’hydratation humaine.
4. Données humaines : ce que montrent (et ne montrent pas) les essais
Un nombre limité d’études cliniques
Lorsqu’on s’intéresse à la spiruline bleue et à l’hydratation cellulaire, la première constatation est simple : il existe très peu d’essais cliniques spécifiquement centrés sur cette thématique. La majorité des recherches sur la spiruline et ses extraits concernent :
- La performance sportive et la récupération musculaire.
- Les effets sur le stress oxydatif et l’inflammation.
- Les bénéfices sur certaines pathologies métaboliques (diabète, hyperlipidémie).
Autrement dit, les effets directs sur l’hydratation de la peau ou des cellules ne sont pas encore documentés de façon robuste.
Études indirectes sur la peau et le stress oxydatif
Certaines publications cliniques mentionnent toutefois des résultats intéressants, bien que secondaires. Chez des volontaires prenant de la spiruline ou des extraits riches en phycocyanine :
- On observe parfois une amélioration de la tolérance cutanée aux UV, suggérant un rôle protecteur sur la barrière épidermique.
- Des marqueurs de peroxydation lipidique (dommages oxydatifs aux membranes) diminuent, ce qui peut indirectement préserver la capacité des cellules à retenir l’eau.
- Dans le cadre de la récupération sportive, on note une meilleure résilience cellulaire face aux dommages oxydatifs, mais là encore, l’hydratation n’est pas mesurée directement.
Ces indices renforcent l’idée que la phycocyanine agit en amont, sur la protection cellulaire, plutôt que directement sur les flux d’eau.
Les limites méthodologiques
Même lorsqu’elles existent, ces études présentent plusieurs faiblesses :
- Échantillons réduits : souvent moins de 50 participants, ce qui limite la portée statistique.
- Durée trop courte : beaucoup d’essais s’étalent sur 4 à 8 semaines, insuffisant pour évaluer les effets sur la peau à long terme.
- Manque de standardisation : les extraits de spiruline utilisés ne sont pas toujours comparables (taux de phycocyanine très variable).
- Absence de critères objectifs d’hydratation : la TEWL, la capacitance cutanée ou la bio-impédance sont rarement mesurées.
Ces limites expliquent pourquoi il n’existe pas encore de consensus scientifique solide sur le lien entre spiruline bleue et hydratation cellulaire.
Ce qu’on peut retenir aujourd’hui
En l’état, les données humaines permettent d’avancer deux points :
- Oui, la spiruline bleue protège les cellules du stress oxydatif et de l’inflammation, ce qui constitue une base favorable pour la préservation de l’intégrité hydrique.
- Non, il n’existe pas encore de preuve directe qu’elle améliore l’hydratation mesurée par des outils scientifiques chez l’humain.
Cela ne signifie pas que l’effet est absent, mais simplement qu’il reste à démontrer par des essais cliniques rigoureux, avec des extraits bien caractérisés et des méthodes précises de mesure.
5. Mécanismes plausibles de soutien à l’hydratation
Le rôle des antioxydants et de la voie Nrf2
L’un des mécanismes les plus étudiés concernant la spiruline bleue repose sur sa richesse en phycocyanine, dotée d’un fort pouvoir antioxydant. En neutralisant les radicaux libres, cette molécule contribue à limiter les dommages oxydatifs qui fragilisent les membranes cellulaires.
Un autre point clé est la stimulation de la voie Nrf2. Ce facteur de transcription active la production d’enzymes antioxydantes endogènes (superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase). Leur action combinée permet de renforcer la résistance cellulaire, d’améliorer la durabilité des lipides membranaires et donc de soutenir indirectement la capacité des cellules à retenir l’eau.
Cytokines, inflammation et barrière lipidique
La phycocyanine est également connue pour moduler la réponse inflammatoire. Plusieurs travaux ont montré une diminution de cytokines pro-inflammatoires comme TNF-α ou IL-6 après supplémentation. Cette modulation est importante car une inflammation chronique peut :
- altérer les lipides constitutifs du film hydrolipidique cutané,
- fragiliser les jonctions cellulaires,
- et augmenter la perte insensible en eau (TEWL).
En contribuant à maintenir une barrière lipidique plus stable, la spiruline bleue pourrait donc agir indirectement comme un facteur de soutien à l’hydratation cutanée.
Les aquaporines : hypothèse séduisante mais non confirmée
Certains auteurs évoquent l’idée que la spiruline bleue pourrait influencer l’expression des aquaporines, en particulier l’AQP3 dans l’épiderme. Ces protéines régulent les flux d’eau et de glycérol, et leur rôle est fondamental dans l’équilibre hydrique.
Cependant, il est important de souligner qu’aucune étude clinique solide n’a encore démontré ce lien direct. L’hypothèse reste donc plausible mais spéculative, en attente de validation expérimentale.
Synergies avec d’autres nutriments
L’action de la spiruline bleue sur l’hydratation cellulaire pourrait être optimisée en synergie avec d’autres nutriments :
- Acides gras essentiels (oméga-3, oméga-6) : renforcent les membranes et le film hydrolipidique.
- Céramides : jouent un rôle majeur dans la cohésion de la barrière cutanée.
- Polyphénols : antioxydants complémentaires qui protègent les lipides et les protéines.
- Vitamine C et zinc : nécessaires à la synthèse du collagène et à la régénération tissulaire.
Ainsi, la spiruline bleue n’est pas une solution isolée, mais peut s’intégrer dans une approche nutritionnelle plus globale.
Les effets de la spiruline bleue sur l’hydratation cellulaire sont probablement **indirects** : réduction du stress oxydatif, protection des lipides membranaires, modulation de l’inflammation. Ces mécanismes créent un terrain favorable au maintien de l’eau dans les cellules, mais les preuves directes chez l’humain manquent encore.
6. Conseils pratiques (non médicaux) et usage responsable
Choisir un extrait de qualité : critères à considérer
Le marché de la spiruline bleue est en plein essor, mais la qualité des produits est très variable. Pour maximiser l’intérêt potentiel de la phycocyanine, plusieurs critères sont à prendre en compte :
- Teneur en phycocyanine : les produits peuvent contenir de 15 % à plus de 60 % de phycocyanine. Plus le taux est élevé, plus l’extrait est concentré.
- Méthode d’extraction : une extraction douce (sans solvants chimiques, sans chaleur excessive) permet de préserver l’intégrité de la molécule.
- Stabilité du pigment : la phycocyanine est fragile et se dégrade sous l’effet de la lumière, de l’oxygène et de la chaleur. Un produit bien encapsulé ou protégé est plus fiable.
- Origine de culture : privilégier une spiruline issue de cultures contrôlées (absence de métaux lourds, de microcystines et de contaminants).
- Traçabilité : exiger des certificats d’analyse indépendants prouvant la pureté et l’absence de substances indésirables.
Ces critères sont essentiels car la variabilité des extraits explique une grande partie des résultats contradictoires observés dans la littérature scientifique.
Formes disponibles et modes de consommation
La spiruline bleue se retrouve sous plusieurs formes :
- Poudre : pratique pour colorer des boissons, smoothies, yaourts. Cependant, la stabilité peut être limitée si le produit est mal conservé.
- Capsules ou comprimés : plus pratiques pour un dosage régulier et une meilleure protection du pigment.
- Liquide concentré : utilisé parfois en complément alimentaire ou en formulation cosmétique, mais sensible à l’oxydation.
- Formulations encapsulées : liposomes, microencapsulation, qui visent à protéger la phycocyanine et à en améliorer la biodisponibilité.
Le choix dépend avant tout de l’usage recherché (alimentaire, cosmétique, complément nutritionnel) et de la stabilité du produit.
Précautions d’emploi et publics particuliers
La spiruline et ses extraits sont généralement considérés comme sûrs, mais certaines précautions doivent être rappelées :
- Grossesse et allaitement : par principe de précaution, l’utilisation d’extraits concentrés n’est pas recommandée sans avis médical.
- Personnes souffrant de maladies auto-immunes : la spiruline pouvant moduler l’immunité, une vigilance est conseillée.
- Troubles hépatiques ou rénaux : éviter une consommation excessive, car l’élimination des pigments et des protéines sollicite ces organes.
- Interactions médicamenteuses : prudence avec les traitements immunosuppresseurs, anticoagulants ou hypoglycémiants.
- Allergies : bien que rares, certaines personnes peuvent réagir aux protéines de spiruline.
En dehors de ces situations, la spiruline bleue peut être envisagée comme un complément alimentaire, mais jamais comme un substitut à une bonne hygiène de vie.
L’importance d’une approche holistique
L’hydratation cellulaire ne dépend pas d’un seul ingrédient. Pour en tirer un bénéfice réel, la spiruline bleue doit s’inscrire dans une approche globale comprenant :
- Une hydratation adéquate (1,5 à 2 litres d’eau par jour, ajustés selon l’âge, le climat, l’activité physique).
- Une alimentation équilibrée riche en antioxydants, acides gras essentiels, vitamines et minéraux.
- Une protection cutanée externe : éviter les expositions prolongées aux UV, utiliser des crèmes hydratantes adaptées.
- Une bonne hygiène de vie : sommeil suffisant, gestion du stress, limitation du tabac et de l’alcool.
Dans ce cadre, la spiruline bleue peut agir comme un soutien complémentaire, mais elle ne remplace ni une bonne hydratation ni des habitudes de vie adaptées.
La cosmétique à base de spiruline bleue
Au-delà de la supplémentation orale, la phycocyanine commence aussi à être intégrée dans certaines formulations cosmétiques. On la retrouve dans :
- des crèmes hydratantes visant à protéger la barrière cutanée,
- des sérums antioxydants destinés à limiter le vieillissement prématuré,
- des soins après-soleil pour apaiser la peau exposée aux UV.
Même si les preuves scientifiques restent limitées, ces applications montrent l’intérêt croissant pour la spiruline bleue comme ingrédient multifonction.
Conclusion
La spiruline bleue, par sa richesse en phycocyanine, est un ingrédient fascinant qui suscite un intérêt croissant dans le domaine de la nutrition et de la santé de la peau. Ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires sont bien documentées, et plusieurs études précliniques suggèrent un rôle dans la protection des membranes cellulaires et la réduction des dommages oxydatifs. Ces effets, en théorie, constituent un terrain favorable au maintien de l’hydratation cellulaire.
Cependant, il est essentiel de distinguer la plausibilité biologique des preuves cliniques. À ce jour, les recherches humaines manquent encore de robustesse : peu d’essais se sont intéressés directement à l’hydratation cutanée mesurée par des outils scientifiques comme la TEWL ou la capacitance. Les résultats disponibles montrent surtout des bénéfices indirects, via une amélioration de la tolérance cutanée et une protection contre le stress oxydatif, mais pas une démonstration claire d’une meilleure rétention d’eau.
En pratique, la spiruline bleue doit être perçue comme un adjuvant potentiel, et non comme une solution unique. Intégrée dans une approche plus large — hydratation régulière, alimentation équilibrée, protection cutanée et hygiène de vie —, elle peut contribuer à renforcer la résilience cellulaire. Mais pour valider pleinement son rôle dans l’hydratation cellulaire humaine, des études cliniques rigoureuses restent indispensables.
La spiruline bleue hydrate-t-elle directement les cellules ?
Non. Les études disponibles montrent surtout des effets indirects (antioxydants, anti-inflammatoires, protection membranaire). Les preuves directes d’une amélioration de l’hydratation mesurée scientifiquement restent limitées.Quelle différence entre la spiruline classique et la spiruline bleue ?
La spiruline classique est l’algue entière, riche en protéines, vitamines et minéraux. La spiruline bleue correspond à un extrait concentré en phycocyanine, le pigment-protéine bleu aux propriétés antioxydantes.Peut-on utiliser la spiruline bleue en cosmétique ?
Oui. On la retrouve dans certaines crèmes, sérums et soins après-soleil pour ses propriétés apaisantes et protectrices, même si les preuves cliniques restent limitées.Quels critères garantissent la qualité d’un extrait de spiruline bleue ?
Un bon extrait doit afficher une teneur élevée en phycocyanine, être issu d’une culture contrôlée, protégé de la lumière et de la chaleur, et accompagné de certificats d’analyse attestant de sa pureté.Y a-t-il des contre-indications à la spiruline bleue ?
Oui, par précaution elle est déconseillée chez les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes atteintes de maladies auto-immunes, de troubles hépatiques ou rénaux, ainsi qu’en cas de prise de traitements immunosuppresseurs ou anticoagulants.1. Romay C, González R, Ledón N, Remirez D, Rimbau V. C-phycocyanin: a biliprotein with antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective effects. *Curr Protein Pept Sci.* 2003;4(3):207-216. 2. Patel A, Mishra S, Ghosh PK. Cyanobacterial pigments as natural anti-oxidants: A review. *Biochem Anal Biochem.* 2017;6(1):1000308. 3. Karkos PD, Leong SC, Karkos CD, Sivaji N, Assimakopoulos DA. Spirulina in clinical practice: Evidence-based human applications. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2011;2011:531053. 4. Riss J, Décordé K, Sutra T, et al. Phycobiliprotein C-phycocyanin from Spirulina platensis is powerfully responsible for reducing oxidative stress and NADPH oxidase expression induced by an atherogenic diet in hamsters. *J Agric Food Chem.* 2007;55(19):7962-7967. 5. Henrikson R. Microalgae Spirulina superfood: the food and medicine of the future. Ronore Enterprises, 2010. 6. Li B, Gao MH, Chu XM, Teng L. C-phycocyanin: properties and biotechnological applications. *Biotechnol Adv.* 2005;23(1):37-53. 7. Tokuşoğlu Ö, Üunal MK. Biomass nutrient profiles of three microalgae: Spirulina platensis, Chlorella vulgaris, and Isochrysis galbana. *J Food Sci.* 2003;68(4):1144-1148. 8. Bertolin TE, Costa JAV. Influence of cultivation conditions on phycocyanin production from Spirulina platensis. *J Sci Food Agric.* 2021;101(1):62-72.